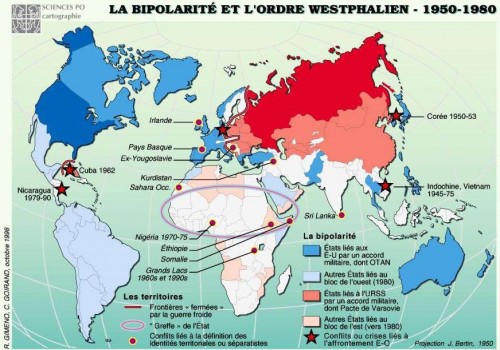Rapports avec les bailleurs et la politique
- ONG très largement soutenues par les bailleurs internationaux (Nations Unies, Union Européenne...), notamment depuis les années 80 … quid de l’impartialité ?
- Qui décide de l’agenda des ONG ? Quelle concertation avec les politiques ?
- ONG de + en + considérées comme des prestataires de services par les politiques et non des partenaires impliqués dans l’élaboration des programmes
- Risque : ONG utilisées comme instrument d’une politique définie
Certaines voix critiques parlent désormais de GONGO pour GOuvernemental Non Gouvernemental Organizations
L'humanitaire d'Etat : intervention pour autrui ou ses propres intérêts ?
- La « coopération » sur des sujets humanitaires apparaît parfois comme un outil au service de la diplomatie. Elle sert les intérêts politiques et économiques de l’Etat par ex.: n'assiste-t-on pas à une nouvelle forme de colonialisme ?
Quels modes d'intervention ?
- Les ONG doivent-elles intervenir partout (exercice du droit d’ingérence en toutes circonstances)? Quelle prise en compte des risques sécuritaires ?
- Les ONG doivent-elle témoigner (quitte à devenir des cibles et à être rejetées par les gouvernements?) ou se taire pour continuer à agir ? Un désengagement doit-il être envisagé sur certaines zones ?
Quelle structuration au sein du mouvement des ONG ?
Constat de départ : Trop de structures, risque majeur d’inefficacité due à une très forte compétition/ concurrence entre ONG. Par exemple, 300 ONG dans la ville de Niamey au Niger : absence très fréquente de collaboration.
- Vers un regroupement important de structures ?
- Les bailleurs encouragent aujourd'hui au regroupement, à travers les appels d’offres : les projets doivent en effet souvent avoir une taille minimum. A noter qu'au niveau français, on estime que les 10 plus grosses associations reçoivent 80% des fonds publics (source : rapport Coordination Sud sur les ONG françaises, 2008-2009
- Comment améliorer la coopération / coordination entre intervenants de l'humanitaire ?
Quel travail avec le Sud ?
Constat de départ : L'action des ONG et des agences humanitaires ne doit pas déséquilibrer ou nuire aux actions menées par les gouvernements ou ONG locales.
- Comment améliorer la collaboration avec les partenaires locaux ?